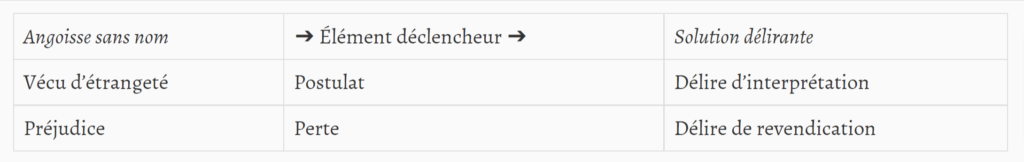Reversal of an instinct into its opposite resolves on closer examination into two different processes : a change from activity to passivity, and a reversal of its content. The two processes, being different in their nature, must be treated separately. Examples of the first process are met with in the two pairs of opposites : sadism–masochism and scopophilia-exhibitionism. The reversal affects only the aims of the instincts. The active aim (to torture, to look at) is replaced by the passive aim (to be tortured, to be looked at). Reversal of content is found in the single instance of the transformation of love into hate.
Sigmund Freud, “Instincts and their vicissitudes” (1915) in The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud vol XIV, Trad. James Strachey, The Hogarth Press, London, 1957, p. 127
Le renversement dans le contraire, à y regarder de plus près, se résout en deux processus différents : le retournement d’une pulsion de l’activité à la passivité et le renversement du contenu. Les deux processus, étant essentiellement différents, doivent être traités séparément. Des exemples du premier processus sont fournis par les couples d’opposés sadisme–masochisme et voyeurisme-exhibitionnisme. Le renversement ne concerne que les buts de la pulsion; le but actif: tourmenter, regarder est remplacé par le but passif : être tourmenté, être regardé. Le renversement du contenu ne se trouve que dans un cas : la transformation de l’amour en haine.
Sigmund Freud, “Pulsions et destins des pulsions” (1915) in Métapsychologie, Folio Essais, Gallimard, 2010, p. 25